Le Bulldozer de Cristal
Mélodie et sa mère, un amour inconditionnel
L’Absence de la mère
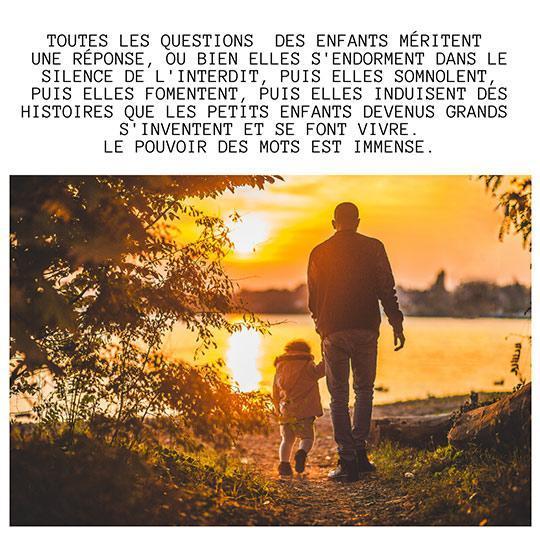
« Quand il faut apprendre à vivre sans sa mère …
« Nous l’avons enterrée, j’ai chialé. J’ai chialé toute l’eau de mon corps. Comme une madeleine, à ses pieds arrosés de mes larmes, comme une fontaine, comme un veau arraché aux mamelles. »
Thalia Remmil – Le Bulldozer de Cristal

Dans sa bulle, ma mère au lit ; on m’avait dit « leucémie ». Mémé avec ses mots : « Ta mère va partir au paradis, tu verras, près de toi, elle restera ». J’avais neuf ans et neuf mois. Je m’en souviens exactement parce que je dessinais des traits sur les murs de ma chambre. 90. Comme c’est court trois mois à vivre ! Comme c’est impitoyable au regard de son jeune âge ; féroce au mien, sans aucune indulgence. Scélératesse que la décision d’un dieu ou destin !
Je m’étais précipitée sur l’encyclopédie à la lettre L, leucémie : « cancer des cellules de la moelle osseuse faisant partie des hémopathies malignes. On l’appelle aussi cancer du sang ». Le souci dans les définitions, c’est la compréhension de certains mots inconnus. J’avais ensuite cherché hémopathies et malignes. Mais surtout, j’aurais remué le ciel, la terre, l’univers, pour y trouver mes réponses à la guérison de cette « maladie du sang grave pouvant se généraliser et entraîner la mort ».
À neuf ans, la mort apparaît un abandon, je dirais même une trahison. J’avais cette sensation qu’une prison m’avait mise sous scellés, comme punie d’un crime dont j’étais innocente. Dingue comme les enfants se croient toujours coupables du malheur de leurs parents ! La mort, telle une harpie féroce. La tête ornée de longues plumes noirâtres, les yeux noirs intenses, le regard fier, les pattes courtes et robustes aussi épaisses qu’un poignet, les doigts puissants munis de serres recourbées, aiguisées comme des aiguilles, chasseuse de vies, prêtes à plonger entre les branches instables du souffle haletant de sa proie. La mort, massive, imposante, dressée derrière une apparente inactivité. Elle surveille les derniers instants d’un rythme cardiaque ralenti, presque en arrêt respiratoire. La mort, prédatrice redoutable, à l’affût de la moindre fragilité des corps affaiblis. Elle guette. Positionnée en sournoise attaque, elle observe avec une attention toute particulière les imperceptibles mouvements de l’existence qui n’en peut plus de tenter d’en réchapper. La mort, inquisitrice, de son regard qui transperce si par malheur vous le croisez. La mort, ici et là, partout à la fois, sur mes joues de mes larmes qui s’écoulent, dans mon cou dégoulinent, sous mes draps se glissent, c’est la mort qui se glisse, j’ai mal à en crever.
Ma mère craignait de me parler de la sienne. Au-delà de sa propre angoisse, elle envisageait ma propre angoisse, terrifiante. Sous-jacente, ma révolte, ce feu jaillissant de l’éruption volcanique tapie au fond de moi. Maman vivait mes émotions. Elle les projetait à l’intérieur de sa propre souffrance, tout en gardant à son visage cet inlassable sourire qu’elle me tendait sans le moindre indice de la douleur lancinante lui parcourant l’échine. Ce sourire, clarté sidérale en mon humeur maussade, resta mon talisman au même titre que le pendentif en or jaune et camée en agate bleue qu’elle portait au cou. Elle me l’offrit quelques jours avant son départ. À l’arrière sont gravés les prénoms de Mémé et Pépé ainsi que la date de leur mariage. Ce bijou, Rose le lui avait confié comme un porte-bonheur protecteur, censé éloigner le mal de son corps affaibli.
Dans ma tête, trois mois de confusion, mon corps en ruine. Je sentais mes os, ma peau, ma chair se néantiser ; l’anarchie régnait à l’intérieur, je coulais lentement. Les Cent-Jours de ma guerre à moi. L’aventure mélodienne. Je tentais de rétablir la paix, on m’assiégeait ; j’essayais de sortir la tête de l’eau, on me piégeait, on me désagrégeait.
Mon empire, « ma mère », se disloquait au fur et à mesure que la maladie empirait. Je voyais son squelette affaibli s’enfoncer dans la mousse du matelas, avalé, inhalé, happé. Je la sentais partir loin de moi, impuissante à ne pouvoir la retenir, et je ne me suis jamais sentie aussi désarmée qu’en ces instants. Je n’ai jamais réussi à oublier ces images. Il me suffit de fermer les yeux pour qu’elles ressurgissent. Pires que la mort, ces images de déchéance ont marqué mon enfance. Pourtant, ces images, poignantes autant que prégnantes, sont aussi celles de la résistance. Je sais aujourd’hui ce qui a germé en ma conscience durant ces dix années passées aux côtés de ma mère, cette femme d’exception : ma capacité de résilience.
Ma mère, Myriam, elle rimait avec miam-miam, mon entrée, plat, dessert ! Mes céréales, mes BN, mes friandises ! De ses sourires à sa bonne humeur, une régalade qu’en ma bouche à pleines dents j’avalais. Une flambée de rires, élixir de caresses qu’en allégresse elle me distillait !
« Mon amour, mon bébé, mes yeux verts, mes p’tits pieds ! »
Elle fredonnait souvent, le bonheur de bonne heure, du matin jusqu’au soir. Je fus sa félicité, jusqu’au dernier battement de cils, son éclaircie, sa force, sa rémission. Dans mes souvenirs, je garde de son visage la joie des lendemains. Au plus difficile de sa maladie, fatiguée et usée, la rutilance au coin de ses yeux de biche émeraude, aussi verts que les miens de chat, ne quittait pas son visage. Mon regard nyctalope. Elle ne supportait plus la lumière alors mes pupilles aux lumières naturelles de la nuit s’éduquèrent, car d’elle, je ne voulais rien rater, d’elle je me vampirisais, d’elle j’abusais. Trois mois durant à ses côtés, je me refusais au reste du monde.
